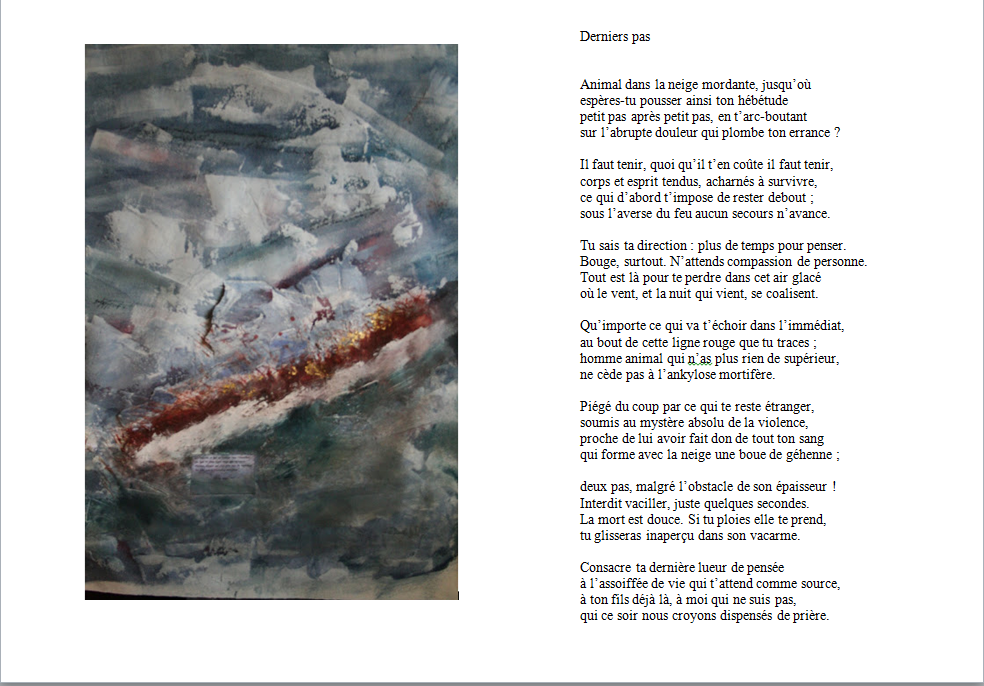Les 24 dernières heures de Gourou, shar-peï.
(Notes autobiographiques)
LA VEILLE
Circulation très fluide ; ce qui ce samedi ajoute à mon malaise alors qu’à l’habitude j’éprouve l’appréhension banale des bouchons. Quittons déjà l’A6 pour l’A86 ; effleurons Thiais puis Choisy asymptotiquement, puis très vite, arrivée aux abords du Carrefour Pompadour à proximité de chez nous et à partir duquel depuis près de huit années tu connais parfaitement les lieux et en as toujours célébré l’approche par tes modulations de voix de gorge et de voix de tête, par ton flot d’allégresse jusqu'à la descente de voiture. Cette fois-ci, silence tombal. Même les pneus et la route semblent avoir mis une sourdine. Pendant le virage à droite par lequel on s’extrait de la bretelle, rien ; à celui, en épingle à cheveu, permettant de traverser le pont sur l’autoroute, rien, plus le moindre signe de toi qui ne parviens même plus à relever la tête au-dessus de la ligne de flottaison alors que Gargouille, elle, s’est enfin relevée et que sa bonasse bouillotte ronde se dessine sur le fond pastel de la vitre arrière. Plus que cinq cents mètres à peine ; encore long, dans l’ignorance où je suis de ton état. Une violente bouffée d’angoisse m’assaille ; je baisse les deux vitres avant et le courant d’air fétide aggrave plutôt les choses qu’il ne me soulage. J’arrête l’auto sur le trottoir dans la courte ligne droite qui longe le métro et me précipite vers toi. Je te trouve dans une position d’accablement, accoudé sur tes pattes avant, de tout ton poids, et le reste de ton corps avachi, sur le côté ; sorte de Sphinx dont la partie arrière serait morte. Encore une fois, tes yeux ne quittent plus les miens pendant que je constate l’étendue du désastre et que les pleurs me montent du ventre quand je te caresse. Et le plus significatif dont je prends conscience, le plus irréfutable des signes, peut -être, est l’inertie absolue de ta queue quand tu tends tes oreilles à mes dérisoires grattouillements.
« Mon maître que j’aime, merci pour tes bonnes caresses, mais tu sais, il faudrait beaucoup plus de choses ; fais tout ce que tu peux, tout de suite, s’il te plaît, n’attends plus, grand frère humain, parce que je suis de plus en plus mal maintenant. » Après avoir collé ma tête à la tienne trois secondes je referme le coffre avec l’envie de gueuler « Au secours ! » de toutes mes forces. Mais à qui ?
« Pas la moindre amélioration depuis l’injection de Vendredi, au contraire l’état de Gourou s’est aggravé. »
Pardon de dire cela au Docteur, mon chien aimé. Tu comprends, il faut bien que je lui rende compte de l’exacte réalité, c’est notre ami, lui seul pourra peut-être encore trouver une petite solution pour te stabiliser, maintenant que nous sommes arrivés chez nous, on peut y aller immédiatement s’il nous le dit, en trois minutes, parking compris, on a même de la chance qu’il réponde à son cabinet à 13 heures 30.
« Complètement paralysé du train arrière. Mais toute la partie avant de son corps fonctionne très bien. »
Tu vois, je trouve les mots pour valoriser ton état, en faisant le distinguo entre l’avant et l’arrière de ta pauvre constitution selon le cliché du verre moitié vide ou moitié plein, j’essaie de toutes mes forces d’inciter le Docteur à se battre encore pour toi. Je sais pourtant fort bien qu’au fond de notre timbale il ne reste qu’un fond très mince, une infime goutte de vie, et que la faible quantité en accélère la vitesse d’évaporation. Je prends les devants pour te protéger bien qu’en aucune manière le praticien ne songe à t’attaquer, bien sûr. J’ai tout de même la nausée à l’idée qu’il pourrait prononcer une condamnation de type scientifique, aveu d’insuffisance de l’humanité tout entière, que je ne suis pas prêt à entendre.
C’est rien, mon Gourounet, continue de bien fermer les yeux sous mes caresses, te détendre, si j’ai du mal à tenir le combiné de la main gauche et m’étouffe un petit peu maintenant, c’est que je viens de recevoir un coup de poignard en plein ventre, ça va me passer, ne t’inquiète pas, même si la lame ne se contente pas de rester plantée mais m’esquinte tout l’intérieur pendant que le Véto me dit gentiment ce qu’il estime devoir me dire.
Tes oreilles, les plis de ta tête, tes babines, ont la douceur de la soie ou du velours sous mes doigts et ma paume. Tu es encore là, bien là, c’est tout pour moi. Amour. Mais je te la dois à toi aussi, la vérité : il est en train de me dire simplement, pour la seconde fois devant mon insistance ou mes pseudo arguments énoncés en larmes, qu’il ne peut strictement plus rien faire pour toi de raisonnable maintenant, que c’est LA fin, qu’il faut « prendre une décision » sans délai. Tout ce qu’il dit je le savais bien sûr au plus profond de moi, même si ça remontait souvent à la surface pendant le voyage que nous venons de terminer, mais savoir que j’allais te retrouver dès l’arrivée, te tenir contre moi, te cajoler, te papouiller, sans réfléchir au temps qu’il me resterait pour le faire, pouvait encore éclipser de façon fugitive le spectre de ta mort imminente. Tant que je sentais ou pensais les choses par moi-même, elles n’appartenaient pas au domaine des certitudes absolues, mon manque de confiance en moi exerçait curieusement un rôle plutôt rassurant, il restait quelque part une petite place pour l’espoir. Mais prononcée de la bouche du vétérinaire, une telle parole acquiert le tranchant d’une guillotine, ta mort d’ici quelques heures vraisemblablement, devient une loi implacable à laquelle rien ni personne ne peut plus te faire déroger.
Pourtant, petit frère d’élection, mon petit soldat, je jette les dernières forces de mon cœur dans cette guerre dont quelque chose en moi n’accepte toujours pas que nous l’ayons perdue, je questionne, j’argumente, je me bats comme un diable pour ton demi centimètre de bougie restant dont la petite flamme illumine encore mes ténèbres :
« Une chose importante que je voulais vous dire : ce matin, j’ai soulevé de mes deux mains le train arrière de Gourou sur une vingtaine de mètres de façon à ce que seules ses pattes avant soient en contact avec le sol, eh bien, il avançait, Docteur, il retrouvait goût à la marche, allait de nouveau au devant des odeurs inconnues. Je suis sûr que si je pouvais lui faire confectionner, ou peut-être cela existe-t-il tout fait, un appareillage à roulettes avec une sangle pour relever légèrement son abdomen, évitant qu’il le traîne au sol pour se déplacer, il retrouverait goût à la vie pour un temps ; je sais exactement ce qu’il lui faut, je pourrais en faire le croquis. Je suis prêt à payer une fortune pour adoucir encore l’existence de mon chien... »
Sans se départir de sa sympathie ni de son calme il me rappelle que la tumeur foudroyante qui avance empêche de considérer ton handicap sous l’angle strictement mécanique ou moteur, et que dans un petit nombre d’heures, très certainement, elle va commencer à raidir et puis paralyser tes membres avant eux-mêmes. Toutes mes pensées sont réfutées, mes tentatives de prolonger ta vie anéanties, non par l’homme qui connaît bien son métier à l’évidence, mais tout simplement par les faits. Brisé, j’ai une peur maintenant irrationnelle que tu doives partir dans l’instant, comme si quelqu’un pouvait venir jusqu’ici t’arracher à moi.
Le docteur vient de me redire que selon les termes de notre contrat énoncé d’un commun accord le mercredi 19 avril dernier depuis lequel ton cancer nous est connu, le moment est hélas venu de savoir prendre « la décision qui s’impose». (Le terme d’« euthanasie » semble évité pudiquement par lui comme par moi). Il y a un temps vide dans l’échange, que je trouve long et ne parviens pas à franchir ; lui se tait aussi, comme en stand by, attente posée. Je te caresse toujours, tu sembles endormi. Je finis par lui dire
« Aujourd’hui, impossible pour moi. »
d’une façon assez nette pour être indiscutée. J’ajoute après trois autres secondes, avec confiance, que selon moi demain, dimanche, n’est sûrement pas possible pour lui non plus, en toute logique... J’allais donc m’empresser de poursuivre par les mots
« Nous pourrons essayer de voir cela la semaine prochaine »
et lui demander de reprendre tes prises de cortisone sur le champ. Mais j’entends les paroles les plus inattendues et haïssables pour mon cœur : si , il peut bel et bien procéder à l’« intervention » ce dimanche. Constatant de l’autre bout du fil mon état proche de l’étouffement, mon incapacité à articuler quoi que ce soit, il conclue simplement en m’invitant à l’appeler demain vers 11 heures 30 pour « faire le point » ; ce qui clôt notre conversation. Quand je raccroche, je ne sais plus très bien ce que nous nous sommes dit précisément ou non, une sorte d’écho déformant s’interpose en moi, la signification m’en échappe encore davantage : de quoi, au juste, sommes-nous convenus ? Pense-t-il, lui, t’euthanasier demain ? Je fais un effort terrible de mémoire immédiate pour être tout à fait sûr que je n’ai rien dit qui aille dans le sens de l’acte fatal redouté, et que je pourrai encore revenir sur ce qui confusément me paraît tout de même proche d’une décision prise à deux. Je n’ai rien pu objecter aux terribles paroles du vétérinaire, et bien que ne les ayant à aucun moment approuvées je me dis maintenant que l’absence de contradiction valait accord. J’en transpire une sueur glacée. Vas-tu vraiment mourir d’ici un petit nombre d’heures ? C’est la seule vraie question, que les autres permettaient de fuir, dont en fait elles me détournaient.
Combien de temps nous reste-t-il, mon chien que j’aime, et quel temps, surtout ? Tu aurais eu neuf ans dans six mois exactement, et tu n’y arriveras pas. Brigitte rentre d’Arès en milieu de semaine prochaine, et tu n’y arriveras pas. Demain après-midi paraît inaccessible à tes organes, ton souffle de vie. Je vomis ma relation au temps, au centre duquel toi et moi sommes ballottés comme dans une machine folle, sans direction, qui monterait et descendrait sur des toboggans infernaux, s’immobiliserait presque à de stellaires altitudes dans les moments que je passe contre toi à régler nos respirations sur la berçante douceur de notre attachement l’un à l’autre, puis brutalement ferait un piqué de masse lourde lâchée dans le vide, ou un décrochage avec vrilles à soulever le cœur jusqu'à la gorge aux instants, de plus en plus fréquents, où je te vois tenter de changer de position, échouer puis reposer ta tête du même côté, de fatigue et de résignation, l’œil légèrement en biais dans ma direction comme pour me dire
« Pardon, mon maître, je peux plus rien faire d’autre, maintenant. Si tu veux que je te regarde comme avant, il faut que tu viennes te mettre dans mon champ de vision. »
Puis tu regardes à nouveau devant toi, fixement, comme si tu contemplais l’horizon proche et unique auquel peut-être même tu aspires désormais, m’imposant un second décodage de ton silence, très nettement distinct du premier :
« Mon maître aimé, j’ai compris que je m’étais trompé et que tu peux rien faire pour moi, que je suis en train de partir me reposer pour toujours, que ma tendre maîtresse et toi allez poursuivre la route sans moi, avec Gargouille qui ignore la chance qu’elle a. Mais pour moi, c’est bien long de partir, le mieux maintenant serait de pouvoir le faire tout de suite, monter dans la petite barque que tu m’as promise. Peut-être que je peux te demander maintenant ce léger coup de pouce, mon grand sommeil où comme pendant les petits sommeils je pourrai encore parfois jouer avec toi et avec Brigitte, sauter sur vos genoux quand vous m’y inviterez, courir dans l’herbe, faire pipi et caca normalement, comme tous les autres, renifler les traces, gratter le sol, bien manger toutes les bonnes choses comme avant, sauter de joie quand vous rentrerez à la maison en faisant des ronds autour de vos pieds pour vous faire rire, et en « battant la mayonnaise avec ma queue », comme tu disais, ou faire ma toilette sans rien oublier, en me contorsionnant pour simplement me lécher ou me mordiller partout, entre tout le reste encore que je peux plus faire quand je suis réveillé et que sinon, je pourrai jamais plus faire dans ton espace réel, au lieu de tout ça je reste cloué sur le côté, sauf quand tu me déplaces comme un sac de croquettes, me déposes sur un autre tapis encore sec ou sur une serpillière neuve de l’armada que tu en as ramenée en coup de vent du supermarché, pour éponger l’urine qui presque invisiblement coule de ma verge malgré moi sans discontinuer ; le temps a accéléré trop vite, il s’est arrêté maintenant, et celui qui me reste n’est rien, vivre n’est plus vivre. Une semaine ou une heure sont la même chose de toute façon, dans mon état, et je voudrais que tu choisisses le plus court, mon maître aimé. »
Bien que cela résonne en moi d’une manière de plus en plus cohérente je ferais tout pour pouvoir détourner ma pensée de ce qui s’impose à elle impitoyablement, à l’exclusion de l’idée à partir de maintenant caduque de différer la douce mort qui t’est promise. Si je croyais certes savoir qu’il fallait du courage pour regarder de face une pensée pareille, s’y tenir jusqu’aux secondes même précédant l’acte sans céder à la tentation de la réfuter sur un coup de nerf, un coup de tête stupide contre des murs beaucoup plus solides que moi, j’étais loin de me douter de l’arrachement à endurer au fond de mon être pour hisser ma faiblesse à la hauteur de ce que je t’avais promis et pour la transformer en fermeté, sinon en force, (j’espérais n’avoir jamais à honorer ce pacte) le mercredi 19 avril dernier, déjà lointain, en présence du Docteur B. Il n’est que trop clair, pourtant, que tu ne peux que souhaiter toi-même la tenue de notre promesse, que la vraie bonté m’entraîne dans le sens paradoxal de l’euthanasie plutôt que vers la prolongation de ta vie, c’est à dire de ta déchéance. Envers et contre tout, malgré toute raison, je suis encore en quête d’une amorce d’indice, quelle qu’elle soit, qui me permettrait de croire que tu veux encore vivre, comme hier pour la dernière fois, au départ de l’aller vers Brosses, mais ton anéantissement est presque complet et tu donnes l’impression d’espérer la suite logique, en ayant abdiqué toute velléité de retour.
Dieu, ou l’ainsi nommé, sait combien je t’aime et combien tu es encore en vie, tant affaibli, semblant continuer à égrener les heures et bientôt les minutes d’une respiration à cadence rapide qui s’apaise à certains moments sous mes longues caresses, mais ce qui passe de toi à moi ne paraît plus à mon sens qu’un désespoir dévastateur balayant toute lumière dans l’œil de son cyclone, et notre soirée tient déjà de la veillée funèbre. Pour la première fois, un peu de ma résistance commence-t-elle à céder le pas à la fatigue, toujours est-il que je lutte avec moins de certitude pour ne pas manquer de courage, désirant t’assister jusqu’au jour de demain, jusqu’au terme quel qu’il soit malgré mes paupières de plus en plus lourdes. Ce n’est pas du vrai sommeil qui m’enserre ou m’écrase, mais une angoisse chronique, immaîtrisée, paralysante pour mes yeux et mon cerveau. Nous ne sommes plus tous deux que ma longue caresse qui parcourt délicatement tout ton pelage en prenant soin de ne pas appuyer sur tes flancs, sur tes cuisses creuses, à la base plissée de ta queue dont l’inertie révèle l’étendue cachée des dégâts survenus en toi, nous ne sommes plus que l’effleurement à peine perceptible de mes doigts le long de ton épine dorsale, qui ne donne plus désormais la moindre réaction de ta part. Pourtant, je sais que tu aimes ma main posée sur toi comme si elle allait ne plus jamais s’en départir, comme si elle t’appartenait, comme si, le temps suspendu, ton espérance de vie s’accordait soudain à ce que je crois être la mienne. Dans l’espace de cette impression, même fugitive, tu n’es nullement en train de me quitter, petit frère, nous vivrons côte à côte jusqu'à la fin des temps à nous épauler, nous enchanter. Nous sommes rois.
Téléphone. Je sursaute, tiré de mon début de torpeur. Juste le temps de voir l’heure avant de décrocher : 22h 40. La voix humaine qui m’est la plus chère, et que j’ai parfois passé mes journées à attendre, est aussi celle, ce soir, à laquelle il va m’être le plus pénible de parler.
« Bonsoir mon ange. » Je m’arrête là : je suis garrotté. La chose que j’ai à lui apprendre est trop terrible, et n’est, surtout, pas encore une totale certitude pour mon entêtement qui essaie de tout faire pour différer ce dont le docteur et moi sommes pourtant convenus, à savoir la mort douce à te dispenser dès demain. Je vais devoir informer Brigitte, quoi qu’il m’en coûte.
« Alors, ta journée ? »
Cette question largement phatique jaillie de ma bouche est en fait une petite lâcheté dont je ne peux réprimer un sourd sentiment de honte ; il m’est d’abord tellement plus simple de la faire parler. D’emblée, le contraste est saisissant entre les atmosphères respectives autour de nous : à Arès, dans l’enceinte de la colonie municipale, une veillée exceptionnelle préparée depuis le début de leur séjour, fête appelée « la boum » par les enfants en liesse, donne lieu à des jeux, des danses précédant le coucher prévu pour 23 heures, sous la responsabilité vigilante de Brigitte secondée par deux jeunes animateurs pour sa classe. Les cris de joie, la musique, me parviennent un peu assourdis par l’acoustique de la salle de cantine où cela se passe. Elle n’a pu m’appeler avant, et je pense au bout du compte que cet obstacle momentané à la communion de nos pensées est pour l’heure plutôt une chance. C’est presque confortable : je la laisse parler et voudrais que son récit du jour ne prenne jamais fin. Mais un virage serré s’opère dans sa voix qui crisse soudain sur le silence, dérape et s’éraille quand elle s’enquiert de toi qui n’as guère plus quitté sa pensée que la mienne malgré le tourbillon des enfants en fête autour d’elle, dans la formulation de l’abrupte question que je redoutais d’entendre claquer comme un coup de feu. Elle s’est tue. Il faut que je prenne la parole. Je toussote et me racle la gorge avant de parvenir à prononcer les mots
« De plus en plus mal. C’est la fin. »
en prenant tout de suite conscience que cela ne veut encore strictement rien dire ; il y a longtemps en effet que tu vas « de plus en plus mal », et déjà trop de temps aussi que « la fin » a commencé. Rien dans les mots qui viennent de sortir de ma bouche ne peut lui faire comprendre que tu dois mourir demain. Elle se tait toujours. J’entends, à sa respiration oppressée, qu’elle pleure. Cette épreuve est bien notre malheur à tous les trois, et s’il est sûr que d’une part je voudrais être avec ma femme pour l’aider à y faire face, je voudrais par dessus tout que nous soyons elle et moi en train de t’assister. Au lieu de cela, ma solitude aussi démunie que la tienne, et ce soir, - sûrement le dernier, sauf prodige -, à peine moins figée ou prostrée.
« Qu’est-ce qui se passe, exactement ? » me demande-t-elle sans force, d’une voix presque éteinte. Je recommence à déplacer ma main sur ton pelage. Tu es chaud.
C’est affreux, elle ne comprend pas. J’espérais tellement que son intuition, saisissante dans de si nombreux cas, parvînt cette fois encore à pallier le manque de clarté de mes rares paroles articulées jusque-là. Il n’en est hélas rien, son mutisme attentiste m’assomme. Je suis découragé à la pensée de lui décrire précisément le dernier état de ta déchéance et de devoir proférer les mots sans appel apparemment indispensables pour lui faire entendre ce qui au pied même de l’évidence me demeure inintelligible, la décision de ta mort fixée plus ou moins pour demain. Je dis seulement
« Gourou »
comme si l’émergence de ton nom sculpté dans un bloc compact de silence pouvait provoquer un miracle.
Tu ne lèves bien sûr plus la tête, ni ne la déplaces d’un millimètre ; seulement tes yeux opèrent un léger mouvement vers les miens. J’ai les yeux et les narines noyés d’un puissant flot de larmes, je respire la bouche ouverte, et je ne te distingue plus aussi précisément. Tu es devenu à mes pieds une tache claire, aux contours flous. En me demandant «ce qui se passe exactement», je sens que Brigitte cherche à se prouver, la distance aidant, que les choses sont sûrement un peu moins tragiques que je ne les vois, elle essaie de dédramatiser, selon l’habitude, comme diraient mes élèves elle « se la joue » optimiste dans l’espoir de parvenir à nous rassurer tous les deux. Mais cette fois, je sais qu’elle a tort, que c’est elle, la pauvre, qui contourne la réalité telle qu’elle est. Elle souhaite autant que moi que tu vives, mon amour chien.
« Mais... »
Enfin elle se décide à dire quelque chose.
« Tu as vu le vétérinaire ? Qu’est-ce qu’il en dit ?
- Il en dit que plus rien d’autre n’est possible pour Gourou que l’euthanasier sur le champ. Nous avons rendez-vous demain dimanche, dernier délai. » (Samedi)
LE JOUR
Je viens, cette fois, de me rendre chez le vétérinaire en refusant jusqu’au bout de croire ce qui pourtant ne pouvait plus ne pas s’y passer. Je suis sorti de chez nous les bras habités par tes dix-sept kilos de raideur inerte et de tendresse, et reviens maintenant chez nous le corps et l’âme criblés de ton vide, bras déserts et ballants, ajourés comme le bleu ironique du ciel. Ta vie ayant cessé de t’offrir la moindre joie j’ai dû dire oui à ta place à son arrêt définitif et supporter de te voir partir, mon doux petit frère. Ton vide est rivé à moi comme l’était ta présence. Selon les équivalences communément admises entre nos deux formes de vie, d’une égale dignité, tu viens de mourir à l’âge que j’ai en ce moment même. Tu étais la part de moi aimante et silencieuse que chaque matin ressourçait. Je comptais avec toi comme avec la lumière du jour, tu allais de soi avec un amour de vivre sans esbroufe et sans marée basse que rien n’attristait hormis mes petits passages à vide, mes zones d’ombre. Ton effacement du monde visible où je m’attarde me sera longtemps une douleur vive malgré ma certitude que ta présence avec nous est vouée à prendre d’autres formes. Tu n’as jamais été une sorte de hochet vivant et ne vas pas faire l’objet d’un fétichisme idolâtre faisant de toi une statuette en stuc peint ou une photo sous verre jaunissant dans un cadre moulé. Je verrai souvent le monde à travers ton regard, dans la mission que je m’assigne non de me souvenir servilement de nos anecdotes à l’étroite fin d’en restituer l’exactitude figée et immuable comme tous les événements appartenant au passé, mais de creuser encore ton empreinte en moi déjà si profonde, la rendre féconde par la vertu de l’amour vivant, donc te recréer en gardant la conscience très nette que rien dans mes travaux ne sera jamais aussi beau que ce que tu fus. Je ne viens de retracer tes vingt cinq derniers jours de vie dans le menu que pour les extirper de moi et les oublier, comme en nettoyant une blessure on ne peut y laisser le moindre fragment d’écharde, la moindre poussière ou impureté. La cautérisation de surface va s’entreprendre, sans rapport avec les souffrances inextinguibles. Puissent mes rendez-vous avec toi être innombrables dans l’espace infini circonscrit sous mes paupières closes et devant moi, par résurgence de mes visions, tes facéties pétillantes comme la douceur de ton regard longtemps amarré dans le mien me faire rire à nouveau ou fondre en de forts élans de tendresse recueillie. La vie passera mieux avec des repères pareils, lueurs certes infimes mais bien présentes dans sa nuitale et sinueuse quête du sens. Entre autres enrichissements inestimables tu m’auras révélé l’âme même du Chien, que je prenais pour un simple animal de compagnie, et dont le nom hébreu, kelev, semble dire qu’il vient du cœur ; (du lev). Au tréfonds de ma peine je trouve à m’enthousiasmer de ce voisinage linguistique qui me paraît relever de la filiation directe, de la plus étroite parenté. En langue arabe encore, cœur et chien ont une sonorité remarquablement proche, à tel point que leur différence ne serait guère perceptible par une oreille non avertie, et qu’il est difficile de ne pas être séduit par l’hypothèse troublante de leur racine commune. Ce qui est au moins un proche écho ne peut en aucune manière résulter pour moi du hasard, et me ramène encore à Toi, mon chien aimé. Les trois religions monothéistes qui nous importent consacrent dans leurs Tables une place toute particulière, dans l’ordre unique du vivant, à la lignée à laquelle tu appartenais : d’abord, le Coran promeut trois animaux seulement aux régions célestes (ou plus exactement, quatre, avec nous, les hommes), qui accèdent donc au Paradis de Mahomet : le chameau, qui porta ce dernier dans sa fuite de la Mecque, l’âne de Balaam et Kitmer, et le chien des sept dormants, endormi pendant des siècles avec ses maîtres et réveillé en même temps qu’eux, qui fut admis en reconnaissance de sa fidélité et de sa vigilance infaillibles.
Mon chien aimé grâce auquel je recouvre lentement la vue, après la peine dévastatrice qui m’assaille encore par vagues mais de loin en loin et avec un tranchant peu à peu atténué, il me semble que ta chère maîtresse et moi sommes avec toi de mieux en mieux, tout se passant d’ailleurs comme si notre heureuse Gargouille, par une série de mimétismes incroyables ajoutés à sa propre générosité, son goût de vivre qu’elle nous insuffle et qui n’eut d’égal que le tien, te retrouvait elle aussi par le fond, te devenant presque, laissant du moins transparaître ton pétillement dans le sien. Ce nouvel apaisement qui chemine en moi comme une aube commence à me révéler ce qui doit finir par faire la supériorité de ta présence actuelle auprès de Brigitte et de moi (la précédente pourtant n’ayant jamais cessé de nous être merveilleuse) : c’est qu’en nous désormais tu ne pourras plus disparaître, et que je ne cesse de découvrir par petites touches ce que tu m’apportes toujours par la variable lumière du jour interposée, au travers de laquelle j’écoute encore ton chant du monde. Tu nais.
Celui que tu prenais pour ton « maître » :
Henri-Louis. |